Un des grands débats actuels qui agitent l’Eglise Catholique, tourne -et c’est justifié- autour de la place de la femme en son sein. Avec entre autres une question récurrente : peux-t-on ordonner des femmes prêtres ?
La question suscite bien des remous et la hiérarchie catholique est en ébullition dès que le sujet est abordé
[1].
Et si le problème n’était pas là seulement ? Autrement dit, la question posée est-elle la bonne question et la réponse apportée ne cache-t-elle pas autre chose que ce qu’elle dit ?
Une impasse ?

Le problème actuel majeur dans l’Eglise Catholique, fortement souligné par le pape François est le cléricalisme
[2]. Et le cléricalisme est une expression majeure de ce péché fondamental qu’est la soif de pouvoir, de domination.
Être prêtre ou évêque dans une société cléricale comme l’Eglise Catholique a comme conséquence de posséder et exercer un pouvoir immense. Et les femmes en sont largement exclues, sauf à être sous l’autorité d’un prêtre.
Avec le problème ainsi posé l’impasse est double.
- C’est par rapport au ministère sacerdotal une erreur.
- C’est par rapport à la place des femmes -et plus largement des laïcs- dans l’Eglise une autre erreur.
Par rapport au ministère sacerdotal
L’expression « sacerdoce ministériel » souvent employé me semble être au moins maladroite.
Ce n’est pas « le prêtre » qui est au service. C’est le service particulier qui lui est demandé au sein du Peuple de Dieu, et qui lui est reconnu par l’ordination, qui le fait prêtre. Il s’agit bien de
ministère sacerdotal. Le prêtre participe au ministère de l’évêque, au service de la fraction du peuple de Dieu qui lui est confiée : veiller à la fidélité dans la transmission de la foi reçue des apôtres, être le ministre des sacrements, et être le serviteur de l’unité et de la vocation missionnaire du Peuple de Dieu. «
Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l’unique Corps du Christ dont l’édification a été confiée à tous.
[3] »
Par rapport à la place des femmes dans l’Eglise.

La revendication féministe d’accès au ministère sacerdotal peut-il être un appel réel ? Je n’oserai en juger. Je note simplement que des femmes perçoivent cet appel
[4]. Apparemment l’Esprit-Saint se moque de la dogmatique ! Il faudrait peut-être s’en préoccuper autrement qu’en évacuant le problème en le niant ou en apportant des réponses en référence au genre (masculin / féminin) qui sont pitoyables.
[5]Cette revendication par les chrétiennes d’accès aux ministères peut être aussi un désir détourné à plus de participation aux décisions qui sont prises pour elles…sans elles. (Puisque pour accéder à des postes de pouvoir il faut être prêtre…soyons prêtres.)
Une conversion nécessaire.
Il faut se souvenir qu’en occident, le regard de la société sur les femmes a été longtemps conditionné par le regard de l’église avec trois préjugés majeurs :
- Les femmes étaient considérées comme inférieures aux hommes dans tous les domaines : physiquement, intellectuellement et émotionnellement. Comme on croyait que seul le sperme mâle ‘contenait’ l’enfant à naître, les femmes étaient considérées comme des êtres humains incomplets.
- Comme Ève avait provoqué la chute de l’espèce humaine et la perte de la grâce, on pensait que toute femme portait la malédiction de son péché.
- On croyait que les menstruations rendaient impure. En tant que créatures impures, les femmes ne pouvaient s’approcher de l’autel et des offices sacrés.
Il semble bien que pour un certain nombre de clercs ces préjugés aujourd’hui totalement irrecevables continuent à marquer -inconsciemment j’espère- leur rapport au féminin
Et pourtant.
Des femmes se sont formées et ont obtenus des licences, masters et doctorats en sciences religieuses. Leurs compétences sont parfois supérieures à celle des hommes, et en tout cas égales.
Des pas importants ont été réalisés par le Pape François.
Elles peuvent être membres de commissions et même depuis 2017 consultantes et en poste de responsabilité dans des dicastères romains
[6]Le problème du pouvoir dans l’Eglise Catholique -mais je le pense identique dans les Eglises Orthodoxes- ne peut être résolu si on fait de la « théologie misogyne » en allant chercher des arguments dans une tradition qui doit tout au factuel pour tenter d’en faire un dogme intangible.
[7]
Pour résoudre ce problème de pouvoir la solution est simple. Pas besoin d’ordonner des femmes prêtres. Il suffit qu’a tous les niveaux de décision de l’Eglise des femmes, des hommes des couples, soit associés avec voix décisionnelles à la marche de l’Eglise. Que le processus ne soit pas simplement consultatif mais réellement synodal.
La vocation de femmes au ministère sacerdotal n’est pas un problème théologique. C’est un problème de conversion d’un pouvoir de clercs, mâles, à une pratique synodale de l’Eglise Peuple de Dieu.
Je rêve de voir le prochain pape élu par cinquante cardinaux, cinquante théologiennes et cinquante laïcs mariés et célibataires.
L’Esprit Saint n’en soufflerai pas moins -et peut-être même un peu plus- sur le conclave, et mon Eglise Catholique Romaine aurait peut-être une autre allure…
« I Have a Dream » disait le pasteur Martin Luther King. Il s’agissait déjà de libération et de justice.
Je fais un rêve….
Georges Fournier
[3] « Le sacrement de l’Ordre confère aux prêtres de la Nouvelle Alliance une fonction éminente et indispensable dans et pour le Peuple de Dieu, celle de pères et de docteurs. Cependant, avec tous les chrétiens, ils sont des disciples du Seigneur, que la grâce de l’appel de Dieu a fait participer à son Royaume. Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l’unique Corps du Christ dont l’édification a été confiée à tous. » in : CONCILE VATICAN II. Décret sur le ministère et la vie des prêtres presbyterorum ordinis. [En ligne] Vatican 7 décembre 1965. Consulté le 12 juillet 2020.Disponible sur le web : http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_fr.html
[7] Voir Jean-Paul II. Lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis sur l’ordination sacerdotale exclusivement réservée aux hommes. Op cit



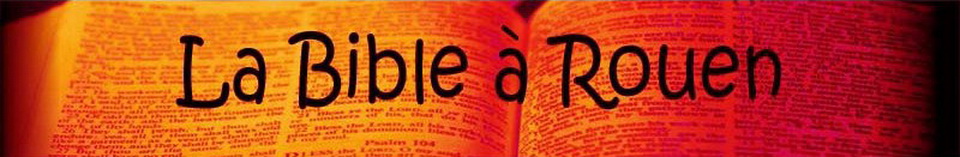

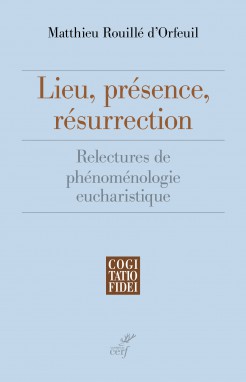






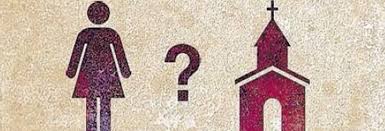


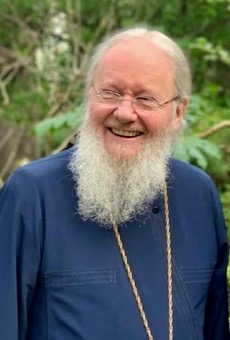




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.