La Bible à Rouen_Programme 2021-2022
Lors de l’assemblée générale, qui s’est tenue en présentiel, au Temple Saint Eloi, le lundi 14 juin 2021, nous avons choisi le thème de l’année :
L’Alliance dans la Bible
Voilà les dates prévues pour cette nouvelle année :
Vous aurez d’autres précisions dans le courant du mois de septembre.
Etude de l’an passé
Les repas dans la Bible, 15 février 2021
Notre première soirée sur le thème : « les repas dans la Bible » a été organisée sous forme de visio-conférence et nous étions une trentaine. Après une présentation globale du thème de l’année qui s’appuie sur une exposition, chaque groupe a travaillé un des textes proposés dans l’invitation, les discussions ont été riches. Certains groupes ont fait des synthèses de leur rencontre sous forme de notes et d’autres ont écrit des phrases plus complètes.
Les repas dans la Bible, 15 mars 2021
Notre deuxième soirée sur le thème : « les repas dans la Bible » a été organisée sous forme de visio-conférence. Après une présentation du thème de la soirée : « Quels aliments allons-nous préparer ce soir ? « , nous nous sommes retrouvés en petits groupes pour travailler certains textes proposés dans l’invitation. Les discussions ont été riches et les synthèses sont indiquées ci-après sous forme de notes.
Les repas dans la Bible, 10 mai 2021
Notre troisième soirée sur le thème : « les repas dans la Bible » a été organisée sous forme de visio-conférence. Après une présentation du thème de la soirée : « Tout est prêt « , nous nous sommes retrouvés en petits groupes pour travailler certains textes proposés dans l’invitation. Les discussions ont été riches et les synthèses sont indiquées ci-après sous forme de notes.
(La suite sur : http://www.labiblearouen.org/spip.php?article163 )
La Bible à Rouen_Programme 2021-2022 Lire la suite »

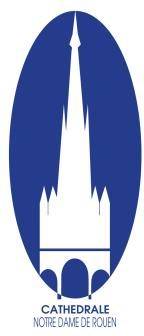
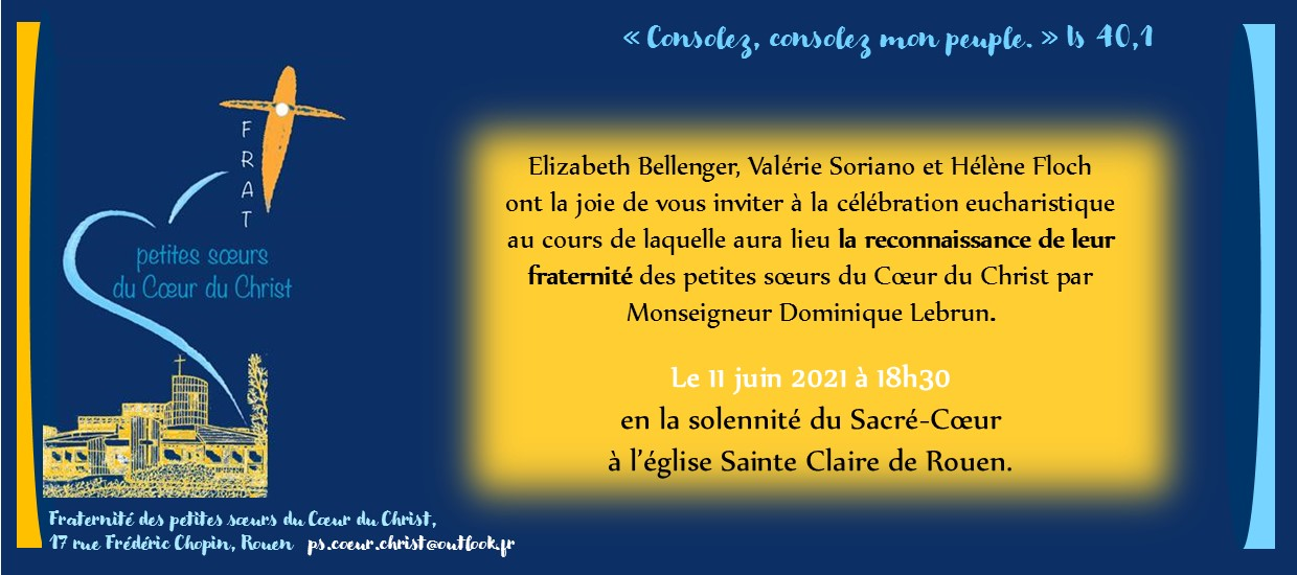
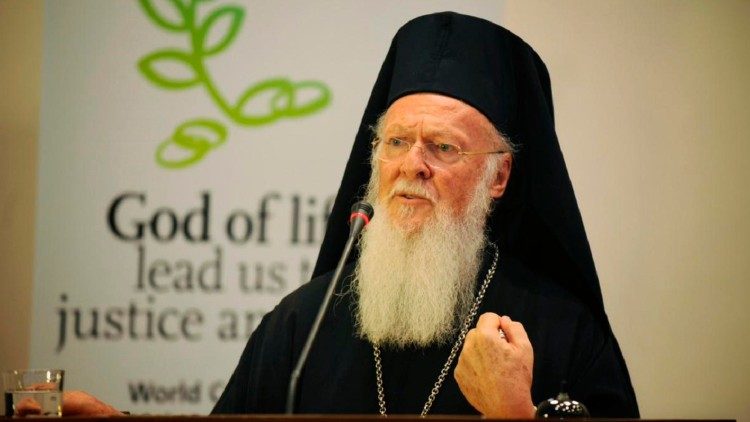



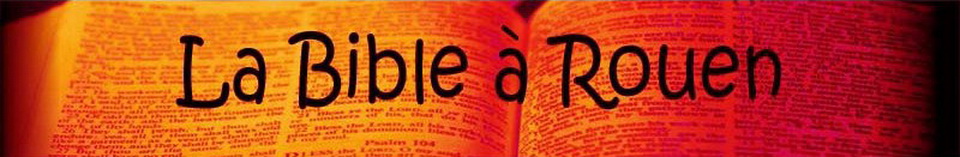

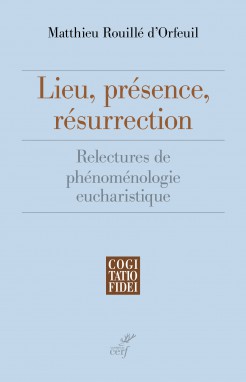


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.